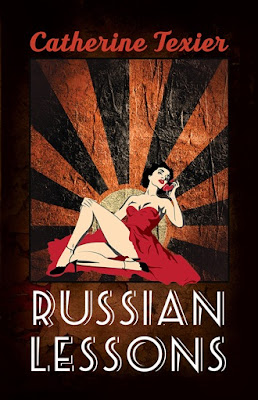|
| Le traducteur au pied du mur. |
 |
| Le Grand Écrivain Inscrire mon nom dans la littérature mondiale |
Foin de l’errance de cristal et des allées sombres du vagabondage, en été 2007, j’étais coincé dans un quartier de grisaille au fond nord-est d’un Paris d’étuve. Arrosant les plantes et nourrissant le chat d’une amie en vacances — Tu ramènes pas des filles !…— je m’occupais à… inscrire mon nom dans la littérature mondiale, rien que ça !… Évidemment, il n’apparaîtrait que comme note en bas de page, mais ce genre d’occase, ça ne se loupe pas !…
Mon vieil ami Jean-François Merle — alors éditeur — qui préparait une réédition Omnibus des Possédés d’un certain Fédor Dostoïevski, m’avait confié la traduction du fameux chapitre maudit La Confession de Stavroguine intitulé en russe Chez Tikhone. Il avait déjà été traduit, mais les droits des traductions n’étaient pas libres !… On a beau dire, la loi d’airain du copyright a certains bons côtés. Je me lançai dans cette tâche sans trop d’appréhension. Si Tolstoï est une épine dans le pied avec sa solennelle pesanteur de grand homme, Lermontov un bonheur par son élégance dandy, Dostoïevski à traduire, c’est l’enfance de l’art. Le feuilletoniste, soucieux de ses créanciers, se préoccupait peu de style. La répétition en russe est certes moins mauvais goût qu’en français, mais même dans sa langue natale, le Grand Écrivain en abusait, son expression était de surcroît d’une simplicité biblique. Le vieux Dostoïevski se distinguait par son imagination en termes d’intrigues et de personnages, mais le raffinement, l’ellipse et l’esthétique manquaient à l’appel. Ce qui donna lieu, il y a quelques années, à une traduction « brute » chez un éditeur devenu ministre de la Culture quelque temps, par un traducteur imbu de lui-même, prétendant « restaurer » l’original. Sur ce dernier point, il n’avait pas tout à fait tort. Dostoïevski, c’est comme Jim Thompson ou Stephen King, l’histoire te dézingue, mais c’est écrit à la truelle !… Lorsque j’exposais ce point de vue à mon vieil ami Merle, il m’ordonna de la boucler. Pas de ce genre de comparaison dans mon volume !… Je ne lis jamais les traductions des autres avant de me mettre au travail, mais il fallut y jeter un coup d’œil toutefois, parce qu’il existait plusieurs versions de ce texte, dont une lourdement réécrite par la femme du Grand Écrivain après sa mort. Le texte original de La Confession… décrit le viol d’une jeune fille par Stavroguine, confessé à un prêtre orthodoxe saint homme, dont le coupable refuse la rédemption et finit par l’insulter. Le goût pour les jeunes filles qu’on attribuait à Dostoïevski qui l’aurait hérité de son père — lynché dans un village slave pour cette raison — n’était pas ce que la femme du Grand Écrivain préférait chez son mari et elle avait considérablement altéré la conclusion du récit, figurant dans l’édition Gallimard. Elle l’avait rendue plus chrétienne, repentir, absolution — vous m’en remettrez une demi-livre !… Dans l’édition russe courante, on avait choisi la version originale, bestiale et nihiliste. Je m’en tins là. Dans ce chapitre, je dois dire que le style était un peu plus élaboré que d’habitude, les ambigüités de Stavroguine, remords, non-remords, confession, mais provocatrice, l’exigeaient. Il me donna un peu plus de fil à retordre que prévu aux jours heureux de la signature du contrat. Mais il y avait une histoire dans l’histoire !… La revue pétersbourgeoise Rousski Vestnik — craignant la censure tsariste devant un récit aussi impie — où le Joueur harcelé par les huissiers livrait son œuvre par épisodes, refusa de publier La Confession… Ce qui enragea l’auteur patrimoine de l’humanité !… Furieux échange de correspondance, Dostoïevski écrivit : Tout est retranché d’une manière très scabreuse, le principal est très abrégé et toute cette extravagance me semble d’une importance considérable (…) Il s’agit (selon ma conviction) d’une catégorie sociale entière, un type de personnalité qui nous appartient en propre, un type russe, un individu oisif non par désir d’oisiveté, ayant perdu tout lien avec ses semblables, et surtout ayant perdu la foi, perverti par son mal de vivre… De plus, Dostoïevski avait conçu ce récit comme chapitre central du roman, non seulement il ne toucherait pas les gages de la revue, lui permettant de régler les factures chez son tailleur ou son caviste le menaçant de prison pour dettes, mais il lui fallait restructurer toute l’œuvre !… Il fulminait !… Mais rien à faire, la revue ne céda pas. Le récit ne parut finalement que bien après sa mort, en 1922, sous les bolchéviques, peut-être pour montrer les vices de l’aristocratie exploitant sexuellement les enfants du prolétariat. Stavroguine est prince et la jeune fille — qui se suicide finalement — est l’enfant de sa femme de ménage. Ensuite, il y eut d’autres coups de théâtre dans l’histoire de cette édition Omnibus. On me proposait — par facilité, je crois — une préface assez médiocre d’une Anglaise experte en Dosto. J’y vis immédiatement l’impérialisme anglo-saxon, écrasant de nos jours, dans absolument tout, y compris hors de leur pré carré !… Je lui préférai — pourvu de multiples fonctions dans ce volume grâce à mon vieil ami l’éditeur — la préface de l’édition courante russe d’un universitaire érudit de Saint-Pétersbourg. C’était bien plus éclairant, intitulé : Toutes sortes de démons tournoyaient. S’il fut assez simple — courriel à l’éditeur russe — de retrouver la trace de Vladimir Tounimanov… Il venait de décéder… J’avais donc affaire à sa veuve… Allait-elle exiger une avance hors de proportion avec ce que prévoyait l’éditeur ?… Deux ans plus tard, à une période très sombre de ma vie de barreau de chaise, comme disait ma grand-mère, je traînais en Ukraine, par un début d’été écrasant lui aussi, à Kiev, qui ne le cède en rien à Paris en termes de pourriture urbaine. L’édition des Possédés était sur le point d’aboutir, il fallait que je décroche les droits de la préface à un tarif possible. Un soir de fin juin, j’étais chez Les Narcotiques anonymes, mes potes ukrainiens depuis mon livre-reportage Vint, le roman noir des drogues en Ukraine, et j’avais déjà vu des dizaines de leurs réunions, ça me cassait les pieds. Dans l’escalier du bâtiment en lisière de la ville, sous les rayons encore vifs d’un soleil écrasant, j’appelai la veuve de mon préfacier. Elle en était ravie et se contenta d’une avance modeste. Ce qui lui importait, disait-elle, c’était que la contribution de son mari à l’exégèse de Dostoïevski porte au-delà des frontières. Mission accomplie en pays slave, à la porte de damnés dignes de Crime et Châtiment… Thierry Marignac 2021. Dostoïevski, Les Possédés, Les frères Karamazov, Omnibus, 2010.
|