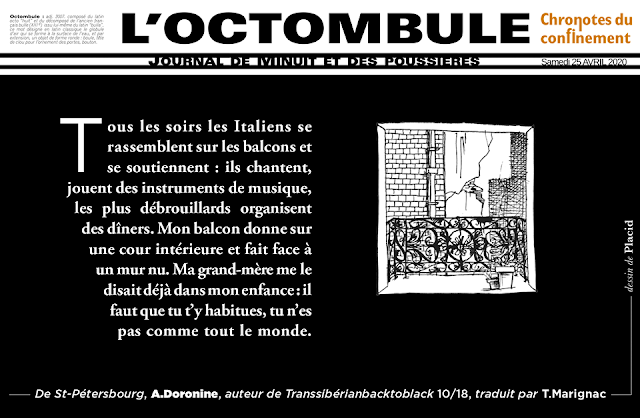LA BOUSSOLE DU CONFINEMENT
La clarté du printemps 2020, sous la chape du diktat mondial, était couleur de plomb. Ce furent deux mois de dérive immobile au fil du temps, parenthèse de l’absurde, où chaque entrevue à distance imposée dévoilait chez l’interlocuteur, un navire glissant sur des gouffres amers… On naviguait sur l’abîme, flux et reflux de cette mort dont on nous rabâchait l’omniprésence, en nous amarrant à l’interdit qui nous bloquait dans notre écluse.
Si, dans la ville septentrionale où j’avais trouvé refuge hors de Phrance, on circulait à peu près librement, sans ausweis auto-signé, sans masque et sans contredanse, les rues largement désertes et les commerces fermés, le silence, la méfiance des passants, évoquaient comme ailleurs le vaisseau fantôme d’une vie suspendue. Le contraste de cette lenteur spectrale sur des eaux stagnantes avec le bouillonnement de l’hystérie officielle, l’hystérie devenue seule parole permise, reprise par tout un chacun à de rares exceptions près, était d’une violence traumatisante, suscitant le déni à chaque surenchère des braillards. La mort rôdait-elle vraiment, à quelques encablures ? Plus tard, cette purée de pois de mots, de thèses et d’antithèses, d’expertise et d’ignorance, d’injonctions contradictoires, fut dissipée, un matin brutal de fin d’hiver, par les canons de l’armée russe. La mort reprenait son allure habituelle et les masques tombèrent.
Pourquoi revenir là-dessus ? Parce qu’en ces temps déjà lointains de l’avis de tempête pandémique, réglés par les vents contraires du doute et de l’incertitude, quelques-uns avaient retrouvé, ou peut-être découvert, la boussole du désir, l’appel du grand large.
À l’heure actuelle, où les furies soufflent à nouveau de toutes parts la folie guerrière sur des océans d’ignorance, il n’est pas inutile de s’en souvenir. Petit changement de cap vers l’œil du cyclone, où les eaux sont plus calmes et la vue plus dégagée.
C’était une initiative du dessinateur-graphiste Philippe Gerbaud, qui eut le coup de génie de réveiller l’instinct, l’humour du naufragé qu’était chacun d’entre nous au cours de cette escale forcée, arrimé à son port d’attache. Il avait baptisé son entreprise Chronotes du confinement. Certes, nous n’avions plus que la chronologie, le mouvement était passible des fers à fond de cale, les quartiers-maîtres de tous les pouvoirs le vociféraient quotidiennement. Je n’en publierai ci-dessous que quelques-unes, que les autres contributeurs me pardonnent…
Pour ma part, si je contribuais activement au rétablissement de l’immunité naturelle par la fantaisie, la rêverie des Chronotes, j’avais, gardant un brin de santé mentale, trouvé un autre stratagème, une autre Croix du Sud, pour traverser cette pause contrainte sans virer louftingue. Ce fut un roman, publié l’année suivante chez Auda Isarn, intitulé Terminal-Croisière. En partie histoire d’amour malheureuse sur un paquebot, en partie interrogatoire policier au port d’Anvers, ses personnages et notamment l’évanescente beauté qui tournait la tête du héros, traducteur comme votre serviteur, me tenaient compagnie, lors de ce confinement prolongé. J’aurais souhaité m’abstenir de claironner ma clairvoyance, confinant, dirais-je sans modestie aucune, parfois à la double-vue et de confirmer la malédiction du romancier-poète Jérôme Leroy à mon encontre — Tu écris tes bouquins trop tôt — mais il s’agissait d’un scandale de corruption à l’UE, d’une enquête menée par des flics belges, sur fond d’hostilité à la Russie…
Je n’aurais bien sûr pas imaginé qu’on trouve des sacs de biffetons chez des parlementaires européens, des dirigeants d’ONG, des syndicalistes, et mon intrigue, l’arnaque décrite était plus sophistiquée. Si j’avais évoqué des valises de billets, on m’aurait jugé partisan et grossier. C’est le genre de choses qu’on ne pardonne pas à un romancier… Mais tous ces personnages étaient là. Je les croyais juste plus raffinés dans la combine.
Quoi qu’il en soit, deux ans et demi plus tard, l’actualité paraît prouver que ma boussole de confinement m’avait bien indiqué le Nord.
En ces temps difficiles, où il importe de retrouver un chemin vers la paix et l’intégrité, ces rappels à la nécessité de l’ironie et du scepticisme s’imposent. Si on vire tous tocbombes — nucléaires — ça n’arrangera rien.
Thierry Marignac, décembre 2022.